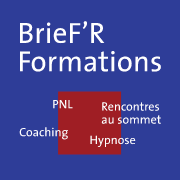Lorsque la porte reste fermée à l’hypnose traditionnelle… essayez d’autres clefs
© Auteurs Jean-Pierre Briefer, médecin-généraliste FMH, hypnothérapeute
Article paru dans le journal CH Hypnose, Vol X, No 2/2000
Résumé
Cet article présente de manière non exhaustive quelques apports de l’hypnose éricksonnienne et de la PNL que l’auteur a jugé particulièrement utiles à sa pratique de l’hypnose. Ces techniques ne sont ni hermétiques ni irrationnelles, elles obéissent à une logique que l’auteur souhaite faire ressortir et transmettre pour vous donner goût de les essayer dans votre pratique
Introduction
Peut-être avez-vous comme moi des patients qui ne viennent qu’une fois et que vous ne revoyez jamais ? Ou alors des patients qui, au bout de dix séances d’hypnose où vous croyez avoir tout compris sur leur problème, vous disent : « votre hypnose, ça n’a vraiment rien changé » ?
Peut-être aussi vous souvenez-vous de vos premiers balbutiements avec l’hypnose où vous vous heurtiez péniblement à un patient qui refusait de fermer les yeux ou de ressentir une quelconque sensation dans sa main droite lorsque vous tentiez de déclencher une lévitation ? Vous vous en êtes sorti avec une pirouette comme : « c’est un patient résistant » ou « c’est un mauvais sujet » ? Mais cette explication ne vous suffit peut-être plus ?
Alors pourquoi n’essayeriez-vous pas de ne pas continuer à faire la même chose ?
L’hypnose éricksonienne, qu’est ce qu’elle apporte de plus ?
Je vous propose d’aller visiter les écrits de Milton Erickson et le nouveau courant d’hypnose qu’il a créé, dont Ernest Rossi, Stephan Gilligan, W.O’Hanlon, Jeffrey Zeig sont les représentants les plus connus. Ils ont quelques clefs intéressantes à nous proposer.
« C’est la clef qui ouvre la porte qui est importante, et non le type de serrure. Analyser et comprendre la serrure n’est pas nécessaire si l’on possède un passe partout qui s’adapte à de nombreuses serrures différentes ! »
Pour eux l’hypnose est un état psychobiologique naturel qui survient spontanément lors de multiples événements de vie. Les conséquences de cette nouvelle notion ne se limitent pas à de simples différences subtiles d’induction entre l’hypnose classique et l’hypnose éricksonnienne bien sûr. Elles impliquent carrément une nouvelle définition de l’hypnose :
« La transe est un état naturel biologiquement nécessaire » (Stephan Gilligan)
« Je crois que la transe n’est pas une chose en soi. C’est un état que le langage permet de caractériser. Il en est tout à fait de même avec l’amour : personne n’a été capable jusqu’à présent de mesurer l’amour, et pourtant vous savez quand vous êtes amoureux et les gens autour de vous peuvent dire quand vous l’êtes ; mais en physiologie, nul n’a pu encore le mesurer ».
1. Etat naturel : cela sous-tend la notion qu’il suffit de guider le patient avec suffisamment de doigté pour qu’il retrouve de lui-même cet état naturel et donc connu. On ne peut plus considérer la transe hypnotique comme un état spécifique déclenché par un hypnothérapeute tout puissant sur un sujet passif. Elle ne dépend pas d’une hypothétique hypnotisabilité, mais d’une série d’événements déclenchants très variés et très individuels.
2. Varié : Il n’y a donc pas une, mais de multiples manières d’induire une transe.
3. Spontané : Seul le sujet peut nous indiquer la bonne méthode et le moment favorable pour lui d’entrer en transe. Il l’indique la plupart du temps non pas consciemment avec les mots mais de manière essentiellement non verbale. Il s’agit donc d’observer, de calibrer et d’utiliser tout ce qu’apporte le patient.
L’hypnose éricksonienne, principes et techniques
Cette nouvelle approche de l’hypnose a débouché sur des techniques, des principes et même une philosophie qu’il est important de connaître :
1. Le principe d’utilisation : est probablement ce que Milton Erickson a apporté de plus précieux à l’hypnose et à la psychothérapie en général :
Il s’agit d’utiliser tout ce que le patient présente dans la consultation verbalement et non verbalement : les soupirs, les clignements d’yeux, les sursauts, aussi bien que les expressions, les croyances sur l’hypnose etc.…
« Vous utilisez tout ce que les sujets amènent dans la situation hypnotique. Vous leur communiquez alors le sentiment qu’il est tout à fait correct de faire ce qu’ils font, et vous les aidez à se servir de ces éléments pour entrer en transe. »
(Erickson cité par Bill O’Hanlon dans « L’hypnose orientée vers la solution » Ed.Satas)
Exemples :
Dans « Life Reframing », E.Rossi rapporte le cas d’une jeune femme qui avait consulté Erickson pour qu’il l’aide à prendre une décision vis-à-vis d’une opération d’hystérectomie. Erickson la mit en transe et la fit se projeter dans le futur, imaginant qu’elle avait subi l’opération. Elle se mit alors à décrire à quel point elle était déprimée depuis cette opération et déclara que si cette dépression se prolongeait trop longtemps, elle finirait par se suicider. Erickson se contenta de lui rapporter ce qu’elle avait découvert elle-même en état de transe.
Dans « Thérapies hors du commun », W.H.O’Hanlon rapporte un cas traité par Erickson qui était « pétrifiée de peur » dès que l’on tentait d’induire chez elle un état de transe. Erickson commença la séance par « vous allez vous raidir, devenir encore plus raide que les fois précédentes. Puis vous fermerez les yeux et vos paupières seront dans un tel état de raideur qu’elles ne pourront plus s’ouvrir ». Elle répondit très bien à ces suggestions paradoxales. Erickson utilisa alors la transe pour lui faire des suggestions post hypnotiques destinées à lui permettre d’entrer en transe de manière agréable à l’avenir.
Il s’agit d’utiliser aussi tout ce qu’il sait déjà faire, ses ressources ou ses expériences antérieures.
Exemple : « Et vous pouvez retrouver la meilleure transe que vous avez jamais eue…»(J.Zeig)
2. La position basse : cette notion très importante aussi a été bien développée par J.A. Malarewicz dans « Cours d’hypnose clinique ». Il s’agit d’une attitude physique, (hauteur du siège plus basse que son patient) et surtout verbale. En résumé, le patient a toujours raison : les échecs sont endossés par le thérapeute alors que les réussites sont attribuées d’abord au patient.
3. L’observation et la calibration du non-verbal : ces notions ont été développées notamment par les Drs Bandler et Grinder sur la base de films vidéos de consultations de Milton H.Erickson, Virginia Satir et Fritz Perls entre autres. Ces techniques sont très précieuses pour rester en phase avec son patient tout en le guidant avec souplesse, savoir comment observer et quoi observer.
« Je pense que les gens en état d’hypnose ont beaucoup plus de contrôle sur eux-mêmes qu’ils pensent avoir. L’hypnose n’est pas un processus de prise de contrôle sur les gens. C’est un processus qui vise à leur redonner un contrôle sur eux-mêmes en leur fournissant un feedback qu’ils n’auraient pas autrement…Si vous pouvez faire la distinction entre ce qui est conscient et inconscient, et amplifier (par feedback) les réponses inconscientes, vous pourrez créer un état de conscience modifié »
« En transe il y a une flaccidité des muscles du visage, et une symétrie qui n’est pas caractéristique de l’état d’éveil. J’ai remarqué qu’il y a d’abord une intensification de l’asymétrie faciale lorsque la personne commence à entrer en transe… »
(R.Bandler et J.Grinder « TRANCE-formations »Ed.Real People Press 1981)
4. Le Milton langage, le langage flou, l’utilisation de la métaphore : sont des procédés linguistiques «naturels » qui favorisent la transe hypnotique : pensez comme un discours monotone et ennuyeux, des consignes absurdes ou ambiguës, aussi bien que des contes merveilleux peuvent déclencher chez n’importe quel sujet un état favorable à la transe hypnotique ou même une transe très profonde !
Erickson a très finement observé ces inducteurs de transe «naturels » et a développé des techniques très efficaces et très indirectes de produire des états d’hypnose.
Les Drs Bandler et Grinder (Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Vol 1) en l’observant ont fait un travail de décryptage et de codification très intéressant.
5. Le paradoxe, la prescription de tâches : sont des techniques également très importantes développées par Erickson aussi bien pour l’hypnose que pour les thérapies stratégiques et comportementales.
Exemple :
Jay Haley rapporte dans « Un thérapeute hors du commun » que Erickson, face à un client trop réservé procédait de la sorte :- Il lui posait une série de questions telles que :« -Votre nom ? Votre prénom ? – Votre âge ? -Vos hobbies ? etc… » sans jamais laisser le temps au client de répondre. Celui-ci au bout de quelques minutes se fâchait immanquablement et demandait à pouvoir parler ! ! !
Conclusion
J’ai appris beaucoup d’autres choses tout aussi passionnantes avec ces thérapeutes de génie, mais je ne souhaite pas et je ne pourrais pas ici être exhaustif.
Je m’arrêterai donc là et je terminerai sur une conclusion plus optimiste pour l’hypnose que mon introduction. L’hypnose a beaucoup d’échecs, comme je l’ai dit au début de mon article, mais je dois avouer que beaucoup de mes patients ont de plus en plus souvent de superbes réussites avec cette technique, et ceci me convainc de continuer.
Auteur :
Dr J-P. Briefer, médecin généraliste FMH
E-mail: jpbriefer@iprolink.ch
Bibliographie
B.Ecker et L.Hulley Depth oriented Brief therapy, Ed.Jossey Bass Inc 1996.
Milton H. Erickson, Ma voix t’accompagnera, Ed. HG 1986.
Edouard Finn Stratégies de communication, Ed.de Mortagne, 1989.
J. Godin, La nouvelle Hypnose, Ed. Albin Michel 1992.
D. Gordon, Therapeutic Metaphors, ED Meta Publications, 1978.
John Grinder et Richard Bandler, TRANCE-formations, Neuro-Linguistic Programming and the structure of hypnosis, Ed.ISBN.1981.
John Grinder et Richard Bandler, Patternsof the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Vol 1
J. Haley, Un thérapeute hors du commun : Milton Erickson, Ed. EPI, 1984.
J. Haley, Uncommon Therapy : The Psychiatric Techniques of Milton H. Erickson, Ed. Norton.
Michel Kerouac, La métaphore thérapeutique et ses contes (études éricksoniennes), Ed MKR.
Jacques-Antoine Malarewicz, Cours d’hypnose clinique, Ed.ESF, 1990.
J. C. Mills et R. J : Crowley, Métaphores thérapeutiques pour enfants, Ed. Desclée de Brouwer.
W. H. O’Hanlon et M. Martin, L’hypnose orientée vers la solution, Ed Satas, 1995.
Ernest Rossi, and Margaret Ryan O., Life reframing in hypnosis : the seminars, workshops and lectures of M.Erickson. New York : Irvington. (1985)
W. H. O’Hanlon et A.L.Hexum, Thérapies hors du commun, Ed SATAS, 1998.